
Nouvel extrait d’un grand petit livre de Pınar Selek, à l’occasion de sa nouvelle édition
par
25 avril 2023
Dès sa sortie en 2015, nous avions longuement évoqué, salué et médité le « grand petit livre » consacré par Pınar Selek à la « question arménienne », et nous en avions publié un extrait. Cet ouvrage reparaît aujourd’hui dans une version augmentée qu’il nous importe de saluer à nouveau. D’abord parce que son autrice, réfugiée en France, affronte depuis plusieurs mois un nouveau chapitre de l’interminable harcèlement judiciaire que l’État turc lui impose depuis plus de deux décennies. Ensuite parce que les huit années qui séparent les deux éditions de ce livre ont vu ledit État et son satrape partir en roue libre dans une radicalisation nationaliste, suprémaciste, fasciste, dont les Arméniens, une fois de plus, ont été des cibles privilégiées. Enfin, et surtout, parce que la centaine de pages de cette nouvelle édition contient, sur la question arménienne mais aussi bien au-delà, sur l’idée de justice, celle de lutte pour la justice, et sur bien d’autres questions, de précieux outils conceptuels, une grandeur d’âme et de coeur inspirantes, et quelque chose comme un mode d’emploi pour sortir l’engagement intellectuel de son ornière glaciale et aristocratique. De ce livre à mettre entre toutes les mains (et en premier lieu les mains gauches, ou plutôt gauchistes, et toutes ces mains militantes qui prétendent nous guider vers d’autres mondes possibles), nous publions aujourd’hui, au lendemain des commémorations du 24 avril, un ajout rédigé par l’autrice en février dernier, en guise d’épilogue ouvert.
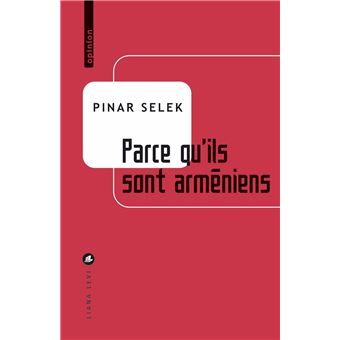
Il y a huit ans j’ai écrit ce texte, comme un appel à la justice, cent ans après le génocide des Arménien.es, pour faire face à l’institutionnalisation du négationnisme de l’État turc devenu une machine de guerre et un danger pour toute la région. J’essayais de témoigner en rendant publique ma propre expérience. À partir d’une auto-analyse, je décortiquais le nationalisme caché qui avait contribué à me façonner. Cette expérience n’était pas facile car, malgré mon appartenance à un milieu progressiste opposé au nationalisme de l’État, j’ai été influencée par les composantes idéologiques du négationnisme.
Je n’avais pas le pouvoir de les effacer alors, en me plaçant sur le devant de la scène, je me suis montrée comme un produit, leur produit. En rencontrant des Arménien.es en Turquie, j’avais découvert les déformations de ma perception : je regardais sans voir car souvent nos regards sont modelés par nos sources d’influences, nos réflexes, nos sentiments, nos idoles, nos goûts. On ne peut pas changer de regard comme on change de lunettes. Pour le corriger il faut se déconstruire totalement. Je l’ai fait. Et aujourd’hui ?
Les années passent. L’institutionnalisation du négationnisme continue.
Le régime autoritaire se consolide. Cette année, on célèbre le centenaire de la République de Turquie, en glorifiant le nationalisme turc. Le pays s’enferme de plus en plus dans un tunnel d’horreurs, sous le silence des pays occidentaux, car leurs intérêts priment.
Les années passent. Ma déconstruction-reconstruction continue.
Après mon arrivée en France, j’ai entamé un nouveau processus de découverte et de transformation. Ma vision était toujours « Turquiecentrée », mais j’essayais de voir plus, de questionner mon regard. Ainsi, ont surgi de nouvelles réflexions devant l’ampleur grandissante de la désinformation, la compromission collective et la généralisation du mal. Dans mon travail de déconstruction j’ai introduit la méthode de fouilles sédimentaires. La sédimentation est un processus bien connu en archéologie : au fil du temps, la matière s’accumule et crée une couche qui renferme de nombreuses informations. J’avais atteint la première couche, la plus visible, dès ma confrontation avec la question kurde. La deuxième correspondait à ma découverte tardive des répercussions du génocide et de l’effacement des Grecs d’Asie mineure.
Ma petite victoire intérieure sur le négationnisme avait suffi pour alimenter chez moi l’espoir. Oui, j’avais cru que c’était bon. Que j’avais été libérée et donc que mon pays pouvait guérir. Or, le mal enraciné n’est pas un rhume, on ne peut pas le soigner avec un peu de miel et de citron.
Loin de ce pays – mon pays ? –, j’ai poursuivi mon archéologie intime et j’ai aperçu les pièces manquantes du puzzle. Sous le joug de la pensée dominante et en proie à une peur permanente, j’avais perdu l’autonomie du jugement et, comme l’écrit Hannah Arendt, je n’étais pas totalement détachée de la banalité du mal : je disais que la barbe de Barbe-Bleue n’était pas si bleue que ça, je gardais l’espoir. Peut-être a‑t-on besoin de cet espoir quand on est attaché à un territoire.
Les années passent. Les rencontres continuent.
Entre-temps, j’en ai fait d’aussi fortes que celles décrites dans ce livre. Elles ont orienté mon regard, fixé sur la Turquie, vers la France et vers la diaspora arménienne. J’ai constaté les difficultés de celle-ci à se reconstruire et à porter ses revendications de justice sur l’espace public international. Pour mieux comprendre, j’ai engagé une recherche sociologique sur les transformations politiques de cette diaspora et j’ai perçu un autre volet de l’Histoire, que je ne connaissais pas. Je croyais que les Arméniens de la diaspora vivaient dans un confort politique et social. Pas du tout. En enquêtant j’ai appris comment la destruction physique, le déracinement et le revirement des Alliés face à la Turquie avaient contribué à rendre difficile la situation des exilé.es dans plusieurs pays, mais aussi à encourager leur regroupement. La communauté diasporique, structurée par la construction politique de la mémoire, aspire à la justice et à la dignité collective. Ces Apatrides, grâce à un travail de fourmi, ont réussi à faire de leur exigence de justice un sujet incontournable des relations internationales. Cet enseignement est aussi précieux que celui de ma déconstruction. J’ai appris que dans toutes les conditions, même les plus difficiles, nous avons le pouvoir de commencer.
Je voudrais donc dédier cette nouvelle édition à Charjoum, mouvement transnational fondé par les jeunes Arménien.es, qui allient une lutte centenaire pour la justice à d’autres mouvements sociaux. Dès mon arrivée en France, j’ai été témoin de leur naissance. Plus qu’une convergence des luttes, entre nous, c’est une histoire d’amour. J’aime leur intégrité, leur intelligence, leur capacité de se questionner et d’aller jusqu’au bout du monde si nécessaire.
C’est une rencontre magique des enfants ou des petits-enfants d’un pays qui s’est construit sur l’extrême violence. Ce pays n’existe plus. Nous n’avons plus de pays.
Les années passent. Nous construisons notre monde.
P.-S.
Ce texte est extrait la nouvelle édition, augmentée, du livre de Pınar Selek, Parce qu’ils sont arméniens, qui vient de paraître. Nous le reproduisons avec l’amicale autorisation des Éditions Liana Lévi.
Partager la publication « Les années passent : tout continue »
