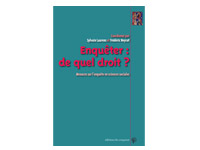
« Je n’allais pas leur donner les noms, c’est une question d’éthique »
Entretien avec Pinar Selek (sociologue turque et militante féministe), mai 2010
Article publié dans « Enquêter, de quel droit ? Menaces sur l’enquête en sciences sociales »
Arrêtée en 1998 par la police turque alors qu’elle mène une enquête sociologique sur le mouvement kurde, la sociologue Pinar Selek refuse de livrer aux autorités les noms de ses enquêtés. Torturée, emprisonnée, elle est alors l’objet d’une incrimination supplémentaire, puisque les autorités l’accusent d’avoir posé une bombe dans le bazar égyptien, marché aux épices d’Istanbul. Une mobilisation nationale et internationale va se développer au fil des années, pour dénoncer les conditions de cette arrestation et l’absence de fondements de ces accusations qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. Libérée en 2000, acquittée à deux reprises en 2006 et 2007, Pinar Selek doit aujourd’hui faire face à une nouvelle épreuve, l’exil : l’État turc entend rouvrir le dossier et les poursuites judiciaires. Malgré la préparation de ce nouveau procès qui lui prend beaucoup d’énergie, elle accepte de raconter son histoire et de revenir sur les justifications, éthiques et sociologiques, de son refus de livrer à la police l’identité de ses enquêtés. Son témoignage clôture cette seconde partie de l’ouvrage en montrant les limites des possibilités d’accommodement des sciences sociales avec l’arbitraire d’une raison d’État. Il invite, à travers la comparaison avec d’autres contextes internationaux, à une réflexion sur ce que pourrait être une pratique de recherche totalement subordonnée à la loi et à l’autorité régalienne d’un État.
C’est en juillet 1998 que vous êtes arrêtée par la police turque à la sortie d’un atelier pour les enfants des rues que vous animiez. Pourriez-vous revenir sur les conditions de cette interpellation et sur les raisons que les autorités turques avancèrent alors pour la justifier ?
Depuis 12 ans, je reviens sans arrêt à cette question. Même si c’est douloureux pour moi de me souvenir, de parler, de revenir sur le déroulement des événements qui constituent un véritable complot. En 1996, j’ai fondé « L’atelier de la rue » à Istanbul. Il n’accueillait pas seulement les enfants de la rue ; le fréquentaient également des adultes, SDF, travestis, transsexuelles, travailleuses du sexe, gays, lesbiennes, des voleurs, des universitaires, des vendeurs ambulants, des collecteurs d’ordures, des musiciens gitans … Un lieu d’échanges, un lieu de mélanges. Le principe était le suivant : les enfants nous apportaient les objets qu’ils avaient trouvés dans les poubelles. Nous travaillions des objets des plus hétéroclites et nous les transformions en oeuvres artistiques. Nous avions un slogan : « Jeter n’est pas facile… » J’avais mobilisé beaucoup de professeurs de mon université pour notre atelier. Grâce à leur participation, nous réalisions les dessins, les sculptures de plâtre, de terre. Nous vendions nos oeuvres et notre magazine dans la rue et ça marchait bien. Nous vendions tous les exemplaires ! Ensuite, nous avons également fondé un théâtre de rue avec le soutien de professionnels. Il y avait beaucoup de bénévoles, des ami(e)s volontaires se joignaient à nous ; nous étions indépendants de toute institution. Dans notre petit atelier libre à Beyoglu (un arrondissement d’Istanbul situé sur la rive européenne du Bosphore), nous partagions nos expériences et nous tentions d’exprimer la parole/les paroles de la rue par ces différentes voies.
Parallèlement, je terminais mon mémoire de master sur les transsexuelles à Istanbul et débutais une recherche sur le PKK, le mouvement des Kurdes. Mon travail reposait sur le recueil d’histoires orales avec les membres de cette organisation. Un jour… une belle journée ensoleillée, oui… en juillet 98, je me suis retrouvée entre les mains de policiers. Ils sont arrivés soudainement, ils m’ont fait monter brutalement dans une voiture et ils m’ont emmenée pour l’interrogatoire. Ils ont saisi tous mes documents de travail et ont commencé immédiatement à m’interroger sur cette recherche et sur les gens à qui j’avais parlé. Je leur ai dit que je travaillais beaucoup avec des groupes d’exclus et qu’un tel travail reposait sur le respect de l’anonymat des personnes interviewées, et qu’en ce sens il m’était impossible d’informer la police. Pour cette recherche, je m’étais d’ailleurs engagée expressément auprès des personnes interviewées, leur garantissant de ne pas révéler leur identité. C’était un problème éthique pour moi et une condition de l’enquête sociologique : je ne pouvais pas donner les noms. Heureusement je n’avais pas inscrit les noms dans mes notes et mes carnets. J’avais écrit seulement x, y, z, etc. Très rapidement, des policiers ont commencé à lire mes textes, pendant que d’autres m’interrogeaient. Ils m’ont dit que « je n’étais pas kurde », que « je venais d’un milieu intellectuel », que « j’avais beaucoup de contacts et un bon avenir », que… si je donnais les noms et que je ne parlais à personne de cette rencontre, ils me libéreraient ; mais qu’ils ne me rendraient pas tout de suite mes textes, ils les garderaient pour les lire : peut être cela allait-il durer une ou deux années. Je n’ai pas accepté cette proposition. Et j’ai bien sûr refusé de les informer, de donner les noms… Ils ont un peu insisté verbalement… Puis une autre étape a commencé : celle de la torture ! Ils m’ont bandé les yeux et ils m’ont emmenée dans un autre endroit. Ils m’ont déshabillée et la torture a commencé. Je ne veux pas raconter le détail des tortures mais la pire de toutes était le carcan palestinien et les électrochocs à la tête. Ça a duré des jours et des nuits. À mesure qu’ils lisaient les documents, les analysaient, ils devenaient de plus en plus violents. Je ne sais pas comment j’ai pu résister et ne pas dire les noms qu’ils me demandaient. Ensuite, je me suis retrouvée plongée dans un film de science-fiction où je jouais le rôle principal. Ils ont nié avoir saisi ma recherche… Ils ont prétendu avoir trouvé des bombes dans « L’atelier de Rue ». Ils m’ont finalement jetée en prison en m’accusant de soutenir le PKK.
En quelques semaines, mes avocats (à peu près 120 avocats) ont pu prouver grâce aux rapports balistiques que les bombes, soi-disant trouvées dans l’atelier, avaient déjà été répertoriées dans un commissariat avant mon arrestation. Persuadée que le cauchemar allait terminer, j’attendais alors ma sortie de prison en pensant toujours à ma recherche confisquée par la police. Mais un mois plus tard, un soir que je regardais les informations dans la salle télé de la prison, je me suis vue à l’écran. On me présentait désormais comme une terroriste, on m’accusait d’avoir posé une bombe au bazar égyptien. Un homme avait « avoué » et prétendait avoir posé une bombe avec moi. Les autorités avaient pourtant à plusieurs reprises déclaré officiellement que l’explosion du bazar était due à une fuite de gaz. Mais « ils » avaient besoin de prétextes pour légitimer leur politique et ils m’ont alors choisi comme symbole : une jeune sociologue turque (et non kurde !) déjà relativement connue pour ses travaux de terrain concrets sur des sujets de fond de la société turque. Une façon de lancer un avertissement aux intellectuels et chercheurs : « Si vous dépassez les limites, vous connaîtrez le même destin que Pinar ! » S’ils m’avaient attaquée directement sur mon travail de recherche, cela aurait pu être l’occasion de grands débats en Turquie et ils le savaient. Et ce pas uniquement dans les milieux universitaires, car j’avais des contacts et potentiellement de l’influence dans des milieux très différents. Ils ont préféré me brûler sur la place publique comme une sorcière du Moyen âge ! Oui, je pense qu’il s’agit également là d’une forme de punition masculine à l’encontre d’une femme mais aussi de toute personne qui oserait sortir du rôle
Tout a donc démarré parce que vous meniez une enquête universitaire sur la question kurde. Pourriez-vous nous dire en quoi consistait cette enquête précisément ? Aviez-vous déjà, parce que vous travailliez sur cette question, rencontré des problèmes similaires ?
C’était la première fois que je travaillais sur la question kurde. Mais je travaillais déjà sur les communautés exclues. J’avais effectué des travaux sur les gitans, sur les enfants de la rue, sur les travestis et les transsexuelles, sur les travailleuses du sexe. Je m’étais penchée également sur la réorganisation des médias, sur le militarisme en Turquie (je militais dans des activités antimilitaristes). Oui, j’avais déjà rencontré, disons, beaucoup de problèmes… Mais pas la torture ni la prison. Ni de telles accusations ! J’avais seulement fait l’objet de menaces. Malgré les difficultés, la guerre qui régnait en Turquie était si pesante et horrible qu’il m’était impossible de fermer les yeux. De plus, la question kurde et de la guerre n’avait pas encore été réellement explorée d’un point de vue scientifique, ni guère étudiée dans les universités. Seul le sociologue Ismail Besikçi avait enquêté et publié des livres sur la question kurde qui lui ont valu d’être emprisonné pendant 15 ans. J’ai commencé à me poser quelques questions et à forger mes hypothèses. Pourquoi des dizaines de milliers de Kurdes prenaient-ils le maquis dans les montagnes ? Quels étaient les fondements de l’organisation PKK ? Et de la révolte kurde ? Quelles analyses faisaient-ils de cette situation ? Comment légitimaient- ils la violence ? Quelles étaient les motivations des militants ?
Et comment tout cela avait-il évolué au cours du conflit ? On le voit, c’était en même temps une sociologie de l’organisation qu’est le PKK…
Vous évoquez un précédent à travers le cas d’Ismail Besikçi. Précisément, les sociologues, ou d’autres chercheurs, sont-ils ainsi contrôlés ou menacés par le gouvernement turc ? Et si oui, sont-ce spécifiquement ceux qui travaillent sur la question kurde ?
Oui, les sociologues sont contrôlés et menacés en Turquie. Surtout, si ils ou elles s’intéressent à des sujets tabous. Comme Ismail Besikçi, accusé de faire la propagande du PKK dans ses livres parce qu’il traite de la question kurde. Mais on aurait également pu évoquer les chercheurs travaillant sur la question arménienne, l’armée, la Nation mais aussi l’histoire de la République. Dans la constitution et le Code pénal, il existe d’ailleurs des lois très explicites. Cela ne veut pas dire non plus que toute recherche sur ces questions est réprimée. Il n’y a, en fait, pas de ligne de cohérence dans les pratiques répressives. Parfois ils ne voient pas ou ferment les yeux et n’interviennent pas. Cela dépend de la conjoncture politique. Et puis les sociologues et les politologues ont appris à connaître les sujets et comment et quand les aborder. On écrit sur les Kurdes, sur les Arméniens, sur l’armée mais attentivement, avec précaution. L’équilibre est très fragile et il peut se briser à chaque instant. Il faut aussi ajouter que depuis la reprise des négociations pour l’entrée dans la Communauté européenne, les autorités turques sont plus prudentes quant à l’usage de la répression et de la censure. Mais vous ne pouvez jamais être sûr d’être à l’abri de poursuites. En 1998, je ne savais pas qu’ils se préparaient à durcir le conflit en allant jusqu’à l’arrestation de Öcalan (le fondateur et chef du PKK). À cette période, il n’était donc pas dans leur intérêt qu’on évoque la question kurde ; or ma recherche était de nature à ouvrir un débat de société
Quelle fut la réaction des associations professionnelles de sociologues ? Et de votre université ?
En général les universités et les professeurs ne se mobilisent pas si rapidement face à des accusations de cette gravité. Les universités ont des règles très strictes édictées à l’époque du coup d’État en 1980. Il règne en Turquie une forte pression sur les milieux académiques. Mais j’ai eu de la chance. Dès les premiers jours, les réactions furent nombreuses. Surtout dans mon université. La section de sociologie a remis au tribunal un témoignage écrit en ma faveur. La réponse ne fut pas toujours institutionnelle mais tous les professeurs ont signé personnellement ce témoignage. Et ça, c’est faire preuve d’un grand courage en Turquie. Des milliers d’intellectuels, des écrivains comme Yasar Kemal, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Vedat Türkali, des académiciens, des ONG ont signé la pétition qui me soutenait. Ils et elles sont venus suivre le procès, ont écrit de nombreux articles dans les journaux et dans les magazines, organisé des conférences dans les universités. Et ce soutien se poursuit jusqu’à aujourd’hui. Dans les universités des lectures de mes livres, des conférences sont organisées, des articles me concernant sont publiés, on prend position… Il y a désormais une campagne nommée : « Justice pour Pinar, justice pour nous tous ! » et aussi « Liberté à Pinar, Liberté à la sociologie ! » Grâce à ce soutien, je me sens plus forte !
Par la suite, avez-vous senti un changement dans votre capacité à mener des recherches (une surveillance accrue, des refus d’entretien) ?
Oui, le procès s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui. Tous mes ami(e) s, mes collègues me mettent régulièrement en garde pour que je sois plus prudente. Mais les couvertures de presse, le fait que les médias parlent de mon cas et de mes travaux, les nombreux soutiens m’ont apporté une certaine notoriété en tant que sociologue. Oui, les difficultés sont grandes mais j’ai pu, grâce à tous les soutiens, les dépasser. Voila, c’est la Turquie… Il y a eu beaucoup de répression, mais aussi de la résistance. Je crois que j’ai pu résister à ce chaos grâce à la solidarité. Dans la prison j’ai écrit un autre livre qui est devenu très populaire en Turquie. Après la prison, j’ai continué mes recherches et à publier des livres, j’ai travaillé dans un journal, je suis l’éditrice d’un magazine théorique féministe… Je peux bien dire que maintenant, d’une certaine façon, je suis encore plus active qu’avant. Les forces militaristes avaient pour objectif de me terroriser… en m’accusant de terrorisme. Mais elles n’y sont pas parvenues. Je suis une personne très ouverte : mes livres, mes articles, mes travaux en témoignent. Alors, après les accusations, le tribunal d’Istanbul a dû reconnaître mon innocence. Je suis ainsi devenue un symbole de justice et une sociologue libre. Mes livres sont devenus très populaires et l’État, dans cette situation, a paradoxalement essuyé une défaite. Le fait d’être une femme a aussi un sens particulier. J’ai osé des choses qu’une femme ne doit pas faire. J’avais dépassé les limites. Oui, malgré moi, je suis devenue un symbole ! Et ils ont continué à combattre ce symbole. Et continuent encore, avec cette nouvelle accusation. Ils ont réouvert le dossier et ils réclament… 36 années de prison. Aussi, il y a à peu près un an, j’ai dû quitter la Turquie.
En exil aujourd’hui, parvenez-vous à continuer d’enquêter comme par le passé ?
Oui, je crois que oui. Après ma libération de prison, j’ai continué mes enquêtes et mes activités. Par exemple mon dernier livre porte sur la construction de la masculinité dans le service militaire. J’ai travaillé sur la base d’histoires orales avec les appelés du service militaire. Ce milieu homo-social constitue un théâtre d’observation privilégié du fonctionnement conjoint du militarisme et des processus constitutifs de la masculinité dans la société. Aussi vous pouvez y trouver de nombreuses illustrations des valeurs dominantes de la société. Suite à ce livre, j’ai de nouveau reçu des menaces. Je crois que l’État était une fois de plus irrité par ma personne, parce que je n´ai pas arrêté, malgré la prison, malgré toutes ces accusations. Cependant, si j’ai pu poursuivre, je crois que c’est encore une fois grâce à la solidarité qui n’a pas diminué toutes ces années. Savez-vous si certains de vos enquêtés ont été menacés à leur tour pour avoir accepté un entretien avec vous ? À ma connaissance, non. La Turquie est un pays étonnant, surprenant, empli de contradictions et de paradoxes… La répression y règne mais souvent la population ne réagit pas docilement vis-à-vis de l’État. Qu’a changé tout cela dans votre pratique d’enquête et votre travail sociologique et quels sont vos projets de publication à venir ? Je me sens un peu fatiguée… Certes, cette fatigue ne m’empêche pas de travailler mais les choses se font moins rapidement qu’avant. Le plus grand changement c’est aussi bien sûr l’exil. Je dois continuer mon travail dans une autre langue, un autre milieu, une autre situation. Je ne peux pas continuer mes recherches en Turquie. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je prépare une thèse de doctorat à l’université de Strasbourg. Je travaille sur les politiques des minorités. Comme avant, je continue à écrire des contes pour les enfants… Mon nouveau livre va être publié dans une semaine. Et le plus grand miracle pour moi : j’écris un roman ! Je me sens vraiment heureuse grâce à ce roman.
Comment pensez-vous que la communauté internationale des sociologues pourrait s’organiser pour lutter contre ce type d’accusations et de dérives ?
Les obstacles érigés contre les sciences sociales, le corsetage de la pensée ne sont pas des phénomènes locaux. Car la science comme l’art ne connaissent pas de frontières. Il faut organiser une solidarité internationale contre les toutes les formes de censure. Je pense que la communauté internationale des sociologues sera probablement plus efficace pour faire pression en Turquie. Mais dans ma situation, ce n’est pas à moi de décider, de coordonner de telles actions ! Quand j’étais en Turquie, j’étais très active et j’organisais des campagnes de solidarité pour beaucoup de choses. Mais maintenant je suis hélas très concentrée sur ce procès et sur mon cas. Depuis 12 années, je lutte et je résiste, pour ne pas m’enfermer dans ce mauvais film… C’est vraiment fatigant.
Propos recueillis par Sylvain Laurens et Frédéric Neyrat
Partager la publication « ENQUETER DE QUEL DROIT ? Menaces sur l’enquête en sciences sociales »
