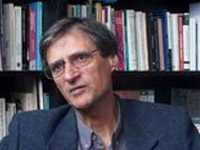
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable »
Retour sur le procès de Pınar Selek
Informations juridiques sur l’évolution de l’affaire, voyez : Documents sur l’affaire Selek puisés dans Info-Türk
Depuis les lendemains de ce 9 février, j’ai souvent essayé d’écrire, en vain. Ni dans les trop brefs moments de joie, ni dans la déception, je n’ai pu trouver le ton juste.
J’aurais voulu écrire immédiatement, pour partager. La préparation un peu fiévreuse et les propos dépourvus d’optimisme inutile, la veille, lors de la réunion présidée par l’avocate Yasemin Öz. « Une seule chose est sûre, avait-elle dit, c’est que cette affaire peut durer encore longtemps ». La foule des amis de Pınar, devant le palais de justice de Besiktas, le matin du 9 février, sous un soleil radieux. Palais de justice au rabais, de style pingre des années 1970, ancien siège de la Cour de Sûreté de l’État, de sinistre mémoire, dans lequel on pénètre par un sas grillagé qui donne l’impression d’entrer, déjà, dans un lieu de rétention. La ferveur dans les déclarations des amis venus d’Allemagne, d’Angleterre, de Suisse, d’Italie, de France, et la détermination des nombreux amis turcs bien sûr, parmi lesquels Yasar Kemal accompagné de Rakel, la veuve de Hrant Dink, Adalet Agaoglu, Ahmet Insel, Oral Çalislar, Akin Birdal… A l’entrée du tribunal, l’accueil d’Alp Selek, le père de Pınar, qui est aussi son avocat, comme le ferait un maître de maison. Son visage, celui de son autre fille, avocate elle aussi, qui nous rapprochent de Pınar. L’audience dans une salle minuscule, où le public se pressait autour d’un espace vide réservé aux bancs des accusés, absents ; au-dessus des juges, un portrait d’Atatürk et la devise : « Adalet devletin esasıdır- La justice est la base de l’Etat ». Les débats, les expertises, les plaidoiries, l’évidence de l’innocence. Les visages fermés des juges, qui ne laissent augurer rien de bon. Puis l’attente.
Nous étions tous restés sur cet espace glauque, notre petite foule constamment parcourue par d’autres justiciables, ou leurs proches, anonymes entraînés eux aussi dans on ne savait quelles arcanes judiciaires, visages inquiets, tristes ou révoltés.
Soudain des cris, ceux de Yasemin Öz sortant du tribunal, criant sa joie dans son téléphone, immédiatement suivie des cris de ses correspondants, à quelques mètres : c’était l’acquittement. Chacun d’entre nous a appris ce mot : beraat. Ruée des caméras, danses, chants, embrassades, pleurs de joie…

On le sait, ça n’a pas duré. C’est par un message de Yasemin, le 11, que nous avons tous été assommés. L’acquittement est remis en cause par le procureur de la république, Nuri Ahmet Saraç.
Cet homme est en charge de l’affaire Pınar Selek depuis le début. C’est lui qui a constamment requis l’emprisonnement à perpétuité. Il a l’obstination d’un écureuil qui tourne en cage, et la cage, c’est son idéologie militaro-kémaliste. Il est un spécialiste des procès à rallonge, c’est sa manière à lui de punir les prévenus, avant même que la peine ne soit prononcée. Le 23 novembre 2009, au cours d’une audience concernant une procédure qui durait depuis neuf ans, l’un des prévenus, emprisonné depuis 2002, n’en pouvant plus, s’est précipité sur lui et lui a cassé le nez d’un coup de poing. Le cas était semblable : le procureur Saraç avait, une seconde fois, cassé un jugement et requis la même peine. L’homme était jugé pour « appartenance à une organisation illégale ». Quelle que soit la réalité de l’accusation, c’est la longueur du processus qui avait provoqué la réaction du prévenu. C’est un système qui vise à briser sa résistance et celle de ses proches.
« La république de Turquie est un Etat de droit laïque, démocratique, respectueux des droits de l’homme » : cette phrase ouvre la présentation du système juridique turc sur le site du ministère de la justice (http://www.uhdigm.adalet.gov.tr). Pourtant, en remettant sans cesse la décision à une date ultérieure, en tentant de casser systématiquement les décisions d’acquittement, la justice turque applique une forme d’oppression dont on ne parle pas assez. Si la Déclaration universelle des droits de l’homme est muette sur ce point, la Convention européenne des droits de l’homme est claire : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » (article 6.1). Tout tient évidemment à ce qu’on entend par « raisonnable ». Peut-être le procureur Saraç estime-il qu’il est « raisonnable » de rendre un verdict au bout de douze, vingt ou quarante ans.
Dans le cas de Pınar Selek et dans d’autres, le refus, à trois reprises, de prendre en compte une sentence d’acquittement est un cas de « jugement indûment retardé » qui constitue en lui seul une violation à la Convention. Or la Turquie, membre du Conseil de l’Europe, a ratifié ce texte en mai 1954…
L’incertitude dans laquelle doit vivre un prévenu dont le jugement est sans cesse retardé, ou sans cesse remis en question, est une torture psychologique. Personne ne peut vivre normalement dans de telles conditions, même si le prévenu n’est pas incarcéré. Dans le cas de Pınar, cette torture s’ajoute aux tortures physiques qu’elle a subies, dont les séquelles psychologiques prolongent les souffrances, et aux trente mois qu’elle a indûment passés en prison.
En faisant peser la menace permanente d’un emprisonnement à vie sur Pınar, et sur d’autres personnes qui subissent le même acharnement judiciaire, que recherchent le procureur Saraç et ceux qui lui donnent des ordres ? Saraç n’est certainement pas assez sot pour espérer que Pınar viendra se livrer à la justice turque si elle est à nouveau condamnée… Mais en maintenant la menace, ils continuent de la punir, non pas pour avoir commis un attentat terroriste, mais pour son travail scientifique et social, pour sa force de caractère, pour son refus de se plier à ce que j’appelle « le consensus obligatoire » qui maintient en Turquie une coercition rigide, sous le masque du culte d’Atatürk. La répression s’opère en permanence sous forme de décisions judiciaires reportées à l’infini. Un procédé, dans ce cas et dans d’autres, qui a le même effet qu’une mesure de relégation, puisqu’il pousse des personnes vivant à l’étranger à ne pas rentrer dans leur pays. Ainsi la Turquie peut-elle se débarrasser de ses prétendus « ennemis intérieurs » sans avoir à légiférer sur la relégation.
Pınar n’est pas seule… pas seule dans son cas, hélas !
Heureusement Pınar est soutenue dans son combat, mais hélas elle est loin d’être seule dans son cas. Ismail Besikçi, un autre sociologue âgé aujourd’hui de 71 ans, a été emprisonné à huit reprises (au total 17 ans), simplement pour son travail de sociologue, comme Pınar. Son domaine de recherche, comme Pınar, est la société kurde. Comme Pınar, il n’est pas Kurde et c’est un facteur aggravant aux yeux du pouvoir. Dans son Hayali Kürdistan’ın Dirilisi (« La Renaissance d’un Kurdistan rêvé », 1998), Besikçi insiste sur la continuité de la répression depuis les années vingt. Le « péché » d’Ismail Besikçi, impardonnable, est de ne pas respecter l’image de perfection de la république « laïque, kémaliste et démocratique », ni celle de l’armée, instrument de répression.
On peut évoquer aussi Esber Yagmurdereli, avocat aveugle, défenseur de la paix et des droits de l’homme, et des opposants politiques dans les années 1970, condamné à la prison à vie (1978), puis à la peine de mort (1985), peine commuée à nouveau en prison à vie : il passe treize ans en prison, simplement pour avoir fait son travail d’avocat, avant une libération conditionnelle en 1991. Mais comme il ne se tient pas tranquille, qu’il continue de réclamer la fin de la guerre dans le sud-est, il est à nouveau condamné en juin 1998 à purger le restant de sa peine, soit 17 ans de prison (http://www.ludovictrarieux.org/fr-page3.1.yagmu.htm). Il a été libéré en janvier 2001.
Yasar Kemal lui-même a connu des déboires avec la justice. En mars 1996, il a été condamné à 20 mois de prison par la Cour de sureté de l’Etat, en raison d’articles sur la guerre au Kurdistan. En 1992, dans un texte publié par Cumhuriyet-Hafta (1), motivé par l’assassinat de Musa Anter (2) et la destruction de la ville de Sirnak, il accuse l’État turc d’une « politique d’oppression archaïque contre les Kurdes menée depuis 70 ans ». 70 ans ! Un « fléau » qui dure, non pas depuis 1984 (début de la guerre contre le PKK) ni depuis 1980 (coup d’Etat militaire du 12 septembre) mais depuis 1922, soit depuis la victoire des kémalistes et la proclamation de la république de Turquie, en 1923. Parole sacrilège ! Implicitement, le premier responsable de l’oppression est donc Mustafa Kemal Atatürk. En Turquie, on admet la critique contre un dirigeant, mais pas contre le Père lui-même, ni contre l’armée qui est son œuvre.
Pınar fait partie de cette triste série. Une seule chose peut nous consoler : elle est en vie et en sûreté. Lors de son arrestation en 1998, elle n’a pas subi le sort du jeune journaliste Metin Göktepe, qui couvrait les révoltes des prisons en janvier 1996, et qui a été battu à mort dans un commissariat. De même qu’elle n’a pas craqué sous la torture physique, et grâce à un cran admirable, elle ne craque pas sous la longue torture psychique qu’elle endure depuis douze ans.
Nous avons cru à un certain changement en Turquie depuis 2002. Nous avons pensé que l’armée, dans l’exercice effectif du pouvoir, perdait son influence, nous avons cru à un affaiblissement du kémalisme dans son rôle de couverture de l’oppression. Mais l’affaire Pınar Selek nous rappelle que l’appareil répressif est toujours là. Il arrive qu’il sommeille, mais il peut être réactivé facilement, et l’arrestation toute récente de journalistes nous montre que le pouvoir de l’AKP peut tout aussi bien copier les méthodes de son adversaire. 61 journalistes, à l’heure actuelle, sont en prison.
Quelle sera la suite de l’affaire Selek ? De façon optimiste, on peut croire, on a envie de croire, que la décision du procureur Saraç est un baroud d’honneur. Il ne voulait pas perdre la face, d’autant que la décision d’acquittement avait été interprétée par la presse comme un « sursaut » du tribunal, et d’autant plus encore que Pınar était soutenue, sur place, par un groupe d’étrangers. Un procureur turc peut-il paraître céder à une pression internationale ? Difficilement. Son attitude serait donc destinée uniquement à préserver son honneur de procureur ; d’une manière ou d’une autre, pensent les optimistes, l’affaire va s’arranger, au besoin discrètement.
Espérons que c’est bien cela, qu’il ne s’agit que d’un dernier sursaut. Mais les arrestations de journalistes de ces derniers jours sont inquiétantes. En attendant, le but de cette sourde méthode répressive est atteint : Pınar doit continuer de vivre dans l’incertitude, condamnée à continuer de mener un combat épuisant.
Pendant ce temps, d’autres intellectuels turcs, des universitaires, tranquillement, publient des panégyriques d’Atatürk ; des artistes se font une rente avec les portraits et les bustes d’Atatürk. Des historiens travaillent à la énième biographie d’Atatürk et au énième récit de la guerre de Libération. Des chorégraphes spécialisés préparent la jeunesse à défiler, à faire de leurs corps des éléments de mosaïques représentant des portraits du Père. Ils apprennent par cœur le Discours du dixième anniversaire, ils répètent des pièces de théâtre sur la guerre de Libération, quelques-uns s’entraînent à la prochaine marche de Samsun à Ankara en l’honneur d’Atatürk. Les filles cousent des costumes pour la fête du 19 mai et quelque part on prépare le plus grand drapeau du monde, et chaque lundi matin, on procède dans les écoles au lever des couleurs.
Tout va bien, her sey yolunda !
Etienne Copeaux
1 Yasar Kemal, « Kürtler insani haklari istiyor [Les Kurdes veulent les droits de l’homme] », Cumhuriyet-Hafta, 2 – 8 octobre 1992. Texte en français dans le Bulletin de liaison et d’information de l’Institut Kurde de Paris, numéro spécial, novembre 1992, pp. 49 – 52.
2 Musa Anter (1920-septembre 1992) est un écrivain, journaliste et militant de la cause kurde.
http://etienne.copeaux.over-blog.fr/article-retour-sur-le-proces-de-pinar-selek-68804123.html
Partager la publication « Retour sur le procès de Pınar Selek »
