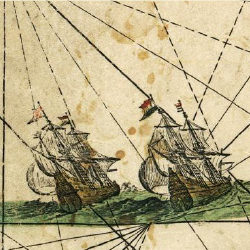
18 – 19 octobre 2018
Université Nice Sophia Antipolis
Organisation :
Odile Gannier, Université Côte d’Azur, CTEL
Véronique Magri, Université Côte d’Azur, CNRS, BCL
Pinar Selek, Université Côte d’Azur, URMIS
Pôle Universitaire Saint Jean d’Angély 3
Bâtiment de l’Horloge, amphi 031 dite « Salle plate »
Bd François Mitterrand – 06300 Nice
Tram depuis la gare : L1 vers Pasteur,
arrêt ‘Saint Jean d’Angély Université’
Contact :
CTEL : Sylvie.Laus@univ-cotedazur.fr
Odile GANNIER : odile.gannier@univ-cotedazur.fr
Véronique MAGRI : veronique.magri@univ-cotedazur.fr
Pinar SELEK : pinar.selek@univ-cotedazur.fr
La critique s’est souvent intéressée aux récits de voyage dus à des voyageurs désireux de découvrir l’ailleurs et d’écrire ensuite leurs découvertes ou leurs impressions ; selon que ce sont des écrivains en voyage ou des voyageurs écrivant, l’analyse des textes peut être différente. La littérature d’exil est aussi bien connue, et analysée par exemple par Edward Saïd : « J’ai défendu l’idée, écrit-il dans Réflexions sur l’exil, que l’exil peut engendrer de la rancœur et du regret, mais aussi affûter le regard sur le monde. Ce qui a été laissé derrière soi peut inspirer la mélancolie, mais aussi une nouvelle approche. Puisque, presque par définition, exil et mémoire sont des notions conjointes, c’est ce dont on se souvient et la manière dont on s’en souvient qui déterminent le regard porté sur le futur. » D’un autre côté, les écritures dites aujourd’hui « migrantes » éveillent davantage l’intérêt des sociologues, qui supposent que le témoignage des personnes se déplaçant ou déplacées relève du récit de vie : aussi ces textes ne sont-ils généralement pas, à ce titre, étudiés sous l’aspect stylistique. Supposant que ces voyageurs d’un autre genre ne s’intéressent pas à leur voyage en tant que tel mais se soucient de sa faisabilité, de sa sûreté et de sa fin favorable, on s’attache ainsi au contenu de leur témoignage et non à leur forme. À la limite, le fait de parler de littérature de voyage en ce qui les concerne peut être soupçonné de futilité hors de propos.
Or, l’objet du présent colloque est de s’interroger sur le discours de ce type particulier de voyage d’exil (et non la situation d’écrivain exilé), le voyage que l’on peut qualifier de « centrifuge », dans le sens où il met une distance douloureuse entre l’individu et son pays d’origine, à moins qu’il ne permette d’échapper à un sort pénible : en tout cas, le souvenir des origines, de la patrie, reste toujours présent et marque de son empreinte les récits des voyages. La relation du voyage centrifuge rend aussi compte de la rupture des attaches, de la perte des repères, qui définit le nouveau rapport de l’individu à l’espace : l’espace extérieur devient intérieur. Comment s’écrit le voyage du déchirement ?
Il ne s’agira cependant pas de vérifier si le récit est authentique ou romancé, mais plutôt de s’interroger sur la forme qu’il peut prendre : s’il se traduit sous la forme d’une relation de mémoires, de journal, de roman, de poésie ou de théâtre, tous ces genres pouvant faire l’objet d’analyses.
» Télécharger le programme complet
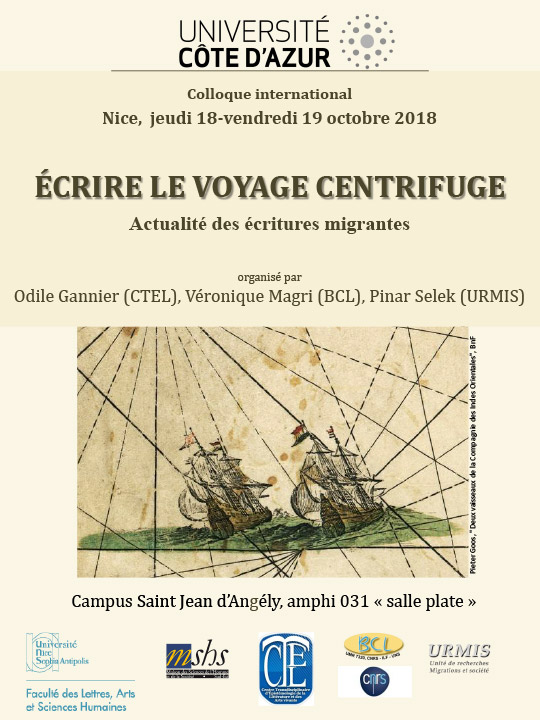
Partager la publication « Écrire le voyage centrifuge : actualité des écritures migrantes »
