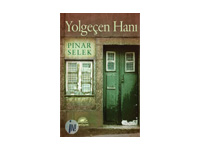
Entretien avec Pinar Selek par Rana Senol,
Agos, 27 mai 2011, à propos de la parution du roman Yolgeçen Hanı 1.
“Les personnages de Yolgeçen Hanı portent la souffrance de cette terre”
Accusée d’être l’auteur de l’attentat du Marché égyptien en 1998, emprisonnée et condamnée à la prison à perpétuité, la sociologue Pinar Selek a passé les plus belles années de sa vie dans les tribunaux de grande instance ; malgré tout, elle nous offre un premier roman plein d’espoir. Yolgeçen Han, publié le mois dernier chez Iletisim, fait revivre les années qui ont suivi le coup d’Etat du 12 septembre 1980. C’est un récit qui met en scène des personnes très diverses, dans un quartier mêlé ; leurs histoires sont faites d’amour, de tristesse, d’espoir, de nostalgie. Malgré ce qu’a vécu Pinar Selek, — ou peut-être en raison de cela – c’est un livre coloré comme la vie, qu’on ne pose pas avant de l’avoir terminé.
RS — Pourriez-vous évoquer brièvement la période au cours de laquelle vous avez écrit Yolgeçen Hanı ?
PS — Lorsque je suis arrivée en Allemagne, il y a deux ans, Yolgeçen Hanı a pour ainsi dire explosé en moi. J’ai ressenti une douleur infinie. Mais j’ai écrit passionnément, aux prises avec l’émotion et la souffrance, et dans un état de bonheur étrange, captée par l’écriture qui a renforcé la vie en moi. En fait, j’avais ce livre en tête depuis longemps, et peu à peu cela s’est traduit en mots ; ce livre a été conçu, le voici qui est né, et j’en suis très heureuse.
RS — Le livre se déroule dans deux quartiers : Bostanci et Yedikule, mais surtout Yedikule… Comment avez vous pu les décrire aussi bien ?
PS — J’ai grandi à Istanbul. Et je n’ai jamais ressenti de limites dans cette ville. J’ai croisé beaucoup de vies. C’est à Bostanci que j’ai grandi, c’est là que je me suis formée. Je connais bien ses particularités, le charme un peu retiré de la vie qu’on y mène. Et j’ai passé beaucoup de temps à Yedikule. Mais si ce quartier a une telle importance dans mon texte, c’est parce que j’y ai vécu, j’y ai fait des rencontres très fortes que je voulais partager.
RS - Dans le roman, Elif est la seule personne qui parle d’elle-même. Les autres apparaissent à la 3e personne du singulier, on les observe de l’extérieur. Est-ce à dire que vous vous identifiez à Elif ?
PS — Le personnage d’Elif ne me ressemble pas. Nous n’avons pas du tout la même personnalité. Mais nous avons un point commun : son père a été emprisonné également, et elle était enfant à l’époque du coup d’État du 12 septembre 1980. Mais j’ai eu plus de chance qu’Elif car j’ai pu franchir ces années noires aux côtés de ma mère, de ma soeur et de tous nos amis. Mais j’ai choisi une route bien différente. Il y a un peu de moi-même dans le personnage de Hasan, et dans celui de Rafi, et même dans celui de Sema. Et beaucoup des personnages que vous avez croisés dans le roman, comme Elif et Fiko, ont réellement fait partie de ma vie. Ce sont des camarades de prison. J’ai écouté leurs expériences, j’ai partagé leurs peines. Aucun personnage ne coïncide exactement avec une personne réelle, mais tous sont des humains qu’on pourrait rencontrer en Turquie, qui portent les marques de cette terre.
RS — L’amitié entre Rafi et Hasan m’a fait penser aux liens ensorcelés entre Rumi et Chams2. Proches de l’amour, au-delà de l’amitié, une relation fondée sur l’admiration mutuelle. Rafi étant arménien, et Hasan étant turc, y a‑t-il une fonction cachée dans le texte ?
PS — Je n’ai pas tellement pensé à Rumi et Chams en écrivant l’histoire de Hasan et Rafi. J’ai plutôt pensé à Karin [Karakasli]. Pendant des années, nous avons été l’âme-sœur l’une pour l’autre. Karin ne ressemble pas au personnage de Rafi, mais nous avons vécu également une amitié qui ne rentre pas dans le cadre des mots existants. Notre histoire est celle d’un partage ; c’est une profonde écoute mutuelle, et le partage de tout ce que nous avions qui nous a protégées des souffrances passées, des problèmes qui nous attendaient, des misères qui s’étalaient sous nos yeux, et de la séparation. Sans se le dire, nous nous sommes tirées l’une l’autre de ce tourbillon qu’on appelle « les contraintes historiques », nous l’avons fait sans détours, et tout naturellement.
Bien sûr, ce roman n’est pas seulement celui de l’amitié entre Rafi et Hasan ; Artin et Cemal, ainsi que beaucoup d’autres, sont unis par des liens solides comme la pierre. Malgré tout ce que j’ai subi, je suis restée debout grâce à ces amitiés. Mon secret, c’est l’amour, et j’ai voulu le partager. C’est ce que dit la chanson : « La beauté sauvera le monde, toute chose commencera par l’amour ». Mais l’amour est une chose bien difficile.
Lorsque Hasan fait la connaissance de Rafi, il s’interroge. Il interroge l’histoire – Komitas 3 et tout ce qu’il ignore, l’histoire qui ne lui a pas été enseignée à l’école. A l’école française, il était sur les mêmes bancs que ses camarades arméniens, mais il n’a jamais pu les approcher. Il remet en cause leur image. Il entreprend alors dans un voyage dans l’histoire et dans son présent, pour se rapprocher de Rafi, de son ami, de ses souffrances. Pour goûter aux fruits de son pommier d’Arménie, il doit prêter une voix à son souffle et penser, réfléchir… Dans une époque d’individualisme, de ségrégation, de discrimination, l’amitié est évidemment difficile. Mais c’est beau, c’est miraculeux…
RS- “Gorille” est un enfant de la rue, Hande est une prostituée… Ce sont des personnes que vous avez croisées au cours de votre vie qui vous ont inspiré ces personnages ?
PS — Oui. Tous les personnages du roman portent les traces de personnes qui, d’une manière ou d’une autre, sont entrées dans ma vie. Je ne voulais pas écrire sur des choses que je n’aurais pas connues, ressenties, intériorisées.
RS- Ce sont les ateliers de rue qui ont inspiré Yolgeçen Hanı ? Un tel atelier ne pourrait-il pas revoir le jour ?
PS — Ça, c’était notre “Yolgeçen hanı”. Ma voie est celle que beaucoup ont suivie, c’est celle de Yolgeçen Hanı. C’était le territoire de ceux que la société a rejetés ! Et qu’est-ce qu’on a fait ? On a essayé de rendre à la vie tout ce qui avait été jeté au dépotoir. On a eu beaucoup de mal au début. C’étaient des gens avec qui je parvenais à entrer en relation individuellement, mais qui restaient distants les uns des autres. Ils ignorent comment faire durer une relation, comment tisser des liens malgré ce qu’ils subissent, les agressions, l’exclusion. Ils ont retrouvé la vie par l’art, nous avons fait éclore des fleurs, nous avons semé. En peu de temps, ce tout petit lieu, notre théâtre de rue, et tout ce qui était produit, les masques, les poteries, les objets en plâtre, les dessins, tout cela a été connu partout. On s’est mis à exposer dans la rue les productions de l’atelier, et on a lancé une revue, Misafir [L’Invité]. On dit toujours que la télé et la vie urbaine ont tué l’hospitalité… Nous avons simplement permis à ceux qui ne pouvaient faire entendre leur voix de s’inviter dans la maison des autres. Nous avons tiré à 3 000 exemplaires, rapidement épuisés grâce aux lien tissés dans la rue. Chaque jour, des dizaines de personnes venaient nous voir, la porte était ouverte à tous, et la nuit, l’atelier était aussi une refuge pour les enfants des rues, les travestis sans domicile. C’était un lieu de rencontre, de fusion. Toute personne en difficulté pouvait s’adresser à nous. Avant tout, ceux qui avaient été rejetés, agressés devaient apprendre, à l’atelier, la confiance dans les autres et en eux-mêmes.
Et ce qui devait arriver est arrivé. Alors qu’on commençait à consolider ce qui était fait, je suis tombée dans ce fameux complot du Marché aux épices, et j’ai été considérée comme le premier rôle de l’histoire. C’était avant tout une attaque contre ce jardin créé dans la boue, cette source dans le désert.
RS- Ce serait une belle chose de pouvoir créer en Turquie des jardins semblables à celui qu’Elif a créé au cours de sa vie d’exilée, un jardin où les migrants, les chômeurs, les sans-logis pourraient planter, semer, et où l’on ferait une cuisine commune ? Un tel projet existe-t-il ?
PS — Oui ! Ces jardins ne sont pas imaginaires ! Il y en a beaucoup en Allemagne, et ça fonctionne ! Il y en a même qui sont tenus par des femmes. Il est vrai qu’ils sont souvent institutionnalisés, organisés, instrumentalisés même par les pouvoirs qui pensent ainsi récolter les voix des étrangers, des ouvriers. Mais les jardins contrôlés par les milieux alternatifs forment une expérience importante. Ce serait merveilleux que ce genre de jardins se répande en Anatolie, en Mésopotamie ! Que ceux qui partagent ce rêve se rassemblent ! Ensuite ce sera facile !
RS- En tant qu’écrivain et sociologue, et compte tenu de ce que vous avez vécu, où va la Turquie d’après vous ? Dans un avenir proche, peut-on espérer des améliorations dans le domaine des identités, des sous-identités dans le pays 4 ?
PS — Je suis optimiste. Depuis vingt ans, le pays connaît un éveil qui ne peut être sous-estimé. Des vérités enterrées, coulées sous une masse de béton, ressortent l’une après l’autre au grand jour. Ceux qui ont assez d’intelligence et des moyens d’expression comment à déchirer l’espèce de camisole de force dont on les avait revêtus, et démontrent qu’il est possible d’opposer sa propre vérité à “la vérité” à laquelle on les avait assignés. Nous avons réussi à opposer d’autres visions à la vision du monde qu’on voulait imposer à chacun. La suite ne sera pas facile. Il y a dans ce pays beaucoup de troubles et de souffrances. Des structures et des institutions bâties par le sang et calcifiées. Elles sont enracinées, solides, bien consolidées. Mais on a mis un bâton dans les roues de ce système ; on ne pourra pas revenir en arrière.
RS - Envisagez-vous d’écrire un nouveau roman ? Avez-vous un autre projet ?
PS — J’ai l’écriture dans la peau, désormais. J’écris continuellement, je remplis sans cesse des carnets. Mais je ne vais pas tout de suite me lancer dans un nouveau roman. Avec l’écriture de Yolgeçen Hani j’ai été sous l’emprise d’une passion. Je n’ai pas la force de me lancer sans transition dans une nouvelle passion. Je dois respirer un peu. Actuellement, je suis occupée par un travail auquel j’ai réfléchi depuis longtemps. J’observe comment, dans les mouvements qui prétendent produire une politique basée sur le genre et l’ethnicité, la lutte pour le pouvoir est mêlée à la politique des libertés. Dans les mouvements de libération qui ont un discours de « liberté », de quelle manière les frontières de la libérations peuvent-elles être rétrécies, comment peuvent-elles être élargies ?
Pour comprendre le monde, expliquer le monde, nous disposons de différentes langues : des concepts, des mots, des images… Je ne veux renoncer à aucun moyen d’expression, je ne veux être confinée dans aucun catégorie. Je veux danser entre les langues. Je veux danser la parole, danser l’esprit, danser la vie.
traduction de turc en francais : etienne copeaux.
http://etienne.copeaux.over-blog.fr/article-le-nouveau-roman-de-pinar-selek-76796195.html
1 Yolgeçen Hani évoque l’idée d’un lieu, d’un han – hôtel, caravansérail, refuge – « où passe la route » (EC).
2 Il s’agit d’une amitié légendaire, entre Celaleddin‑i Rûmi, le célèbre soufi du XIIIe siècle, et Chams, un vieil errant. Ce dernier, venu de Tabriz, aurait rencontré Rûmi, jeune encore, à Konya et serait à l’origine de sa vocation mystique. Leur relation passe pour avoir été fusionnelle : « Je suis ton âme et ton coeur » (EC).
3 Komitas ou Gomidas (1869 – 1896) est un Arménien de premier plan. Ses recherches ethnographiques, notamment en musique, ont donné un nouvel élan à la culture arménienne (EC).
4 Rana Senol fait allusion à l’un des principaux problèmes : l’État ne reconnaît qu’un identité, turque, et chaque citoyen, même
Partager la publication « Le nouveau roman de Pinar Selek »
